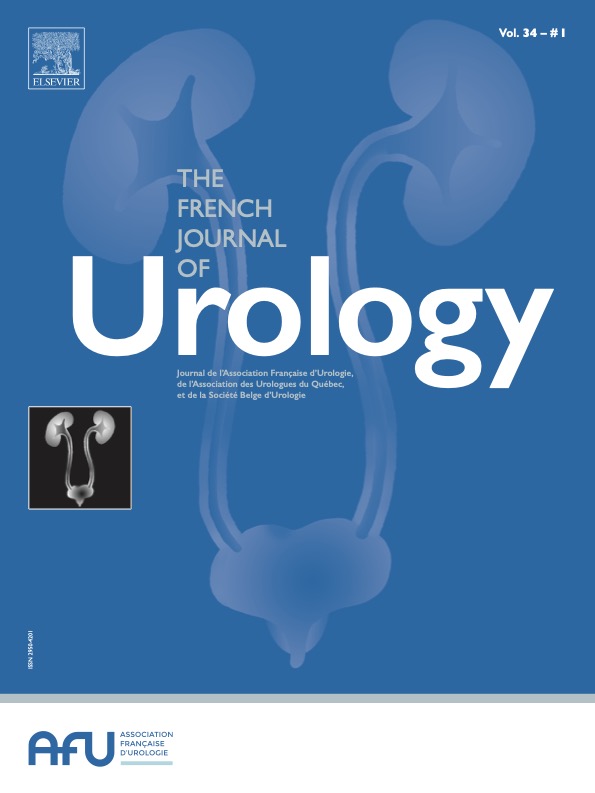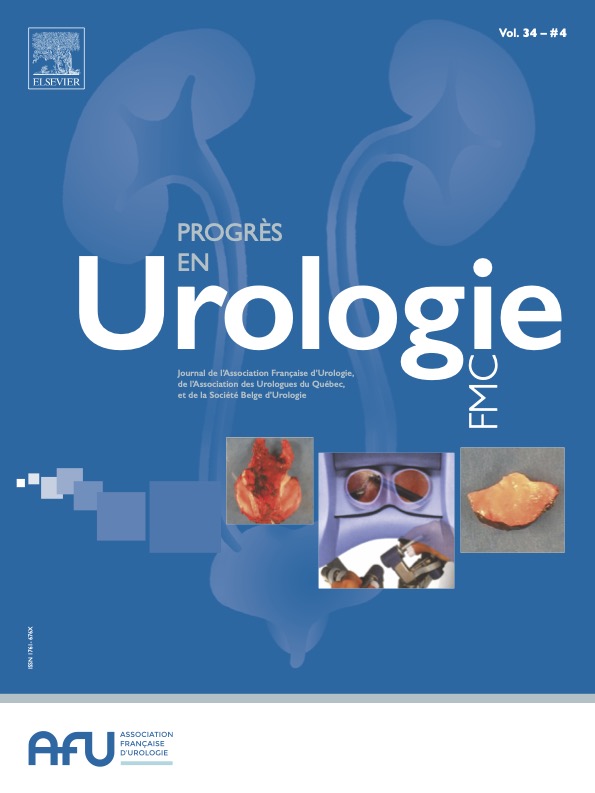| | | Dysfonction érectile Erectile dysfunction | | | | Le terme dysfonction érectile a remplacé, dans les années 1990, le terme impuissance qui pouvait être entendu comme décrivant seulement une dysfonction érectile sévère rendant dans toute circonstance impossible un rapport avec pénétration. L’usage du terme dysfonction érectile rend possible la description d’un trouble plus ou moins sévère (cf. Questionnaires en médecine sexuelle). Le terme dysfonction érectile est la traduction littérale du terme anglo-saxon erectile dysfunction , il y aurait eu avantage à utiliser « insuffisance érectile » à l’image de l’insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale… En effet le priapisme, l’érection prolongée récidivante sont d’autres formes de dysfonction érectile. Cependant, la dysfonction érectile (DE) a été consacrée par l’usage et surtout par l’Agence du médicament qui a utilisé cette terminologie pour la description officielle dans le Résumé des caractéristiques du produit de l’indication des traitements de l’insuffisance érectile. Nous conserverons donc dysfonction érectile (DE) dans l’ensemble de ce texte. La DE est la dysfonction sexuelle la mieux connue, car elle est la plus étudiée. Les progrès de la connaissance physiologique dans les années 1980 ont permis d’appréhender la physiopathologie de la DE dans la décennie suivante et les études épidémiologiques se sont multipliées parallèlement. Ces nombreux travaux de recherche fondamentale et clinique ont accompagné le développement et la mise sur le marché des inhibiteurs de phosphodiestérases de type 5 (IPDE5) qui ont révolutionné la prise en charge de la DE et in fine rendu possible la naissance de la médecine sexuelle. La mise à disposition des IPDE5 majoritairement prescrits aujourd’hui par les médecins généralistes a en effet fait entrer la sexualité humaine dans la pratique médicale courante, la médicalisation de la sexualité était née. Des recommandations françaises, européennes, nord-américaines et internationales ont été proposées pour la prise en charge de la DE [1, 2, 3, 4, 5]. Ce chapitre les prend largement en compte. La DE est un symptôme défini par l’incapacité persistante ou récurrente à obtenir ou maintenir une érection permettant un rapport sexuel satisfaisant. Une évaluation objective ou le déclaratif de la partenaire peuvent aider au diagnostic mais c’est l’affirmation par le patient qui représente l’élément déterminant du diagnostic. Il s’agit donc d’un diagnostic d’interrogatoire [4]. Une durée minimale de trois mois est communément admise pour confirmer le diagnostic. Fait exception à cette règle, la DE postchirurgie pelvienne ou consécutive à un traumatisme pelvipérinéal. La dimension de souffrance du patient et/ou du couple vient compléter cette définition dans la classification des maladies sexuelles de l’association américaine de psychiatrie (DSM-IV) [2]. La DE peut ne pas être la plainte principale du patient et/ou être associée à une autre dysfonction sexuelle i.e. trouble de l’éjaculation en particulier éjaculation prématurée, anorgasmie et/ou manque de désir sexuel. La DE est un symptôme très fréquent avec cependant une prévalence variable selon les populations étudiées et les critères de diagnostic. Il existe, dans toutes les études, une augmentation de la prévalence de la DE avec l’âge. On peut retenir les valeurs suivantes : • | pour les hommes de moins de 40ans, la prévalence est comprise entre 1 et 9 % ;
| • | entre 40 et 49ans, la prévalence demeure généralement inférieure à 10 % s’élevant dans certaines études à 15 % ;
| • | entre 50 et 60ans, la prévalence varie beaucoup d’une étude à l’autre ;
| • | entre 60 et 70ans la prévalence est comprise entre 20 et 40 % ;
| • | au-delà de 70 ou de 80ans, la prévalence est très élevée entre 50 et 100 %.
|
L’âge est un facteur de risque indépendant de DE. Globalement, un mauvais état général, l’existence d’un diabète, d’une maladie cardiovasculaire, d’une maladie psychiatrique, de troubles psychologiques, de conditions socioéconomiques défavorables, d’un tabagisme, d’un déficit hormonal sont des facteurs de risque de DE établis. Le rôle de la iatrogénie médicamenteuse (cf. Iatrogénie médicamenteuse en médecine sexuelle) est également certain. L’activité physique, la minceur, une faible consommation d’alcool, l’absence de tabagisme diminue le risque de DE. Il existe une association entre DE d’une part et l’obésité et le syndrome métabolique d’autre part. Cependant, il n’existe pas de certitude quant au fait de savoir si l’obésité et le syndrome métabolique sont des facteurs de risque à part entière DE ou si le diabète, les maladies cardiovasculaires, voire l’hypotestostéronémie qui leur sont associés expliquent cette association [6]. L’association entre DE et maladies et facteurs de risques cardiovasculaires : accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, cardiopathie, hypertension artérielle, hyperlipidémie, HDL bas, athérosclérose, artériopathie périphérique s’explique par les mécanismes physiopathologiques communs entre DE et les pathologies cardiovasculaires. Il est désormais proposé que la DE pourrait être un signe avant coureur de coronaropathie silencieuse ou à venir. En particulier, la DE serait le meilleur signe prédicteur de l’existence d’une maladie coronarienne silencieuse chez les patients diabétiques indépendamment de l’équilibre glycémique [7]. Il existe par ailleurs une association entre la DE et les troubles mictionnels. L’existence d’une dépression est également associée à la DE. Enfin, les hommes ayant dans leur passé abusé sexuellement d’une femme sont plus à risque de DE [6].
| | La DE peut être classée psychogène, organique (neurogénique, artérielle, caverneuse, hormonale ou iatrogène médicamenteuse) ou mixte : psychogène et organique. Cette dernière forme est la plus fréquente [9]. La commande centrale de l’érection qui fait intervenir des groupes de neurones cérébraux, des centres spinaux, des voies nerveuses cérébrospinales ainsi que des neuromédiateurs au sein du système nerveux central comprenant la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline peut être altérée dans plusieurs circonstances. La iatrogénie médicamenteuse (cf. Iatrogénie médicamenteuse en médecine sexuelle) recouvre des situations où des mécanismes d’action de substances pharmacologiques interfèrent avec la commande neurochimique cérébrale et spinale de l’érection et/ou avec les mécanismes d’intégration cérébrale des stimulations sexuelles aboutissant à un défaut de survenue des mécanismes locaux conduisant à l’érection. Il s’agit essentiellement des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, des neuroleptiques qui interagissent avec la neurotransmission dopaminergique cérébrale, des agonistes de la LH-RH et des antiandrogènes qui inhibent la modulation cérébrale de la réponse érectile. Les lésions de la moelle épinière, le plus souvent traumatiques, mais également présentes dans la sclérose en plaques ou certaines affections spinales plus rares, du fait de l’existence des lésions des corps cellulaires de neurones et/ou de leurs axones sont très fréquemment responsables de DE plus ou moins sévère. C’est plus rarement le cas lors de lésions cérébrales, dans ce cas il s’agit essentiellement de séquelles d’accidents vasculaires cérébraux ou de traumatisme crâniens graves. Il est également possible d’évoquer la responsabilité du système nerveux central dans la DE psychogène. Elle peut-être réactionnelle à un évènement de vie traumatisant personnel, voire professionnel, témoigner d’une anxiété de performance, d’une difficulté au sein du couple, d’un manque de désir ou être la conséquence d’une dépression ou d’une maladie psychiatrique ex. schizophrénie. Des anomalies biologiques pourraient être associées à la DE psychogénique avec : • | une inhibition du centre parasympathique sacré proérectile, voire une activation persistante des centres spinaux thoracolombaires antiérectiles et/ou ;
| • | un tonus sympathique noradrénergique élevé témoin d’un stress responsable d’une contraction exacerbée des cellules musculaires lisses du tissu érectile. Ces mécanismes physiopathologiques permettant d’étayer l’hypothèse d’un support neurobiologique de la DE psychogène n’ont pas fait l’objet de travaux. Cette hypothèse paraît cependant pertinente.
|
Toute lésion de l’innervation périphérique parasympathique proérectile depuis son trajet via les racines sacrées antérieures jusqu’aux terminaisons nerveuses au voisinage des cellules musculaires lisses au sein du tissu érectile est cause de DE neurogénique. Il résulte de ces lésions un défaut de libération de monoxyde d’azote (NO), principal neuromédiateur responsable de la relaxation des cellules musculaires lisses caverneuses, par les terminaisons nerveuses parasympathiques en réponse à une quelconque stimulation sexuelle. Ce défaut de relaxation est responsable d’une DE. Ces lésions de l’innervation périphérique parasympathique proérectile sont l’apanage de la chirurgie d’éxérèse à visée carcinologique pelvienne (prostatectomie totale, cystoprostatectomie, amputation abdominopérinéale du rectum) mais sont également fréquentes lors des cures chirurgicales d’anévrismes aortiques bas-situés intéressant le carrefour iliaque. Ces lésions nerveuses expliquent très vraisemblablement également la DE retardée mais fréquente après radiothérapie pelvienne en particulier pour cancer de prostate. La radiothérapie entraîne en effet des lésions nerveuses différées. Des lésions traumatiques de l’innervation végétative pénienne compliquent également certains traumatismes graves du bassin en particulier en cas de fracture du bassin associée à une lésion de l’urètre bulbaire. Les lésions des terminaisons nerveuses au sein du tissu érectile ont les mêmes conséquences que les lésions d’amont, à savoir un défaut de libération de NO lorsqu’il y a stimulation sexuelle. Il s’agit de la neuropathie végétative du diabète essentiellement. Celle-ci est fréquemment associée à une dysfonction endothéliale ce qui rend les patients diabétiques de type 1 et 2 volontiers difficiles à traiter. Chez les diabétiques, un autre mécanisme est présent, il s’agit du stress oxydant. L’hyperglycémie a pour conséquence l’accumulation des radicaux libres. Ceux-ci altèrent la capacité du muscle lisse caverneux en présence de NO. La description par René Leriche en 1940 du syndrome qui porte son nom correspondant à une oblitération du carrefour aorto-iliaque par des lésions d’athérome avec en autres conséquences « l’impossibilité d’une érection stable ». L’observation de Vaclav Michal, chirurgien vasculaire, dans les années 1970, du lien étroit entre maladie coronaire et DE et la description chez le singe et le chien de l’hémodynamique de l’érection par Tom Lue constituent autant d’étapes clés dans la compréhension de la physiopathologie de la DE d’origine vasculaire. Toute altération de la perfusion pénienne diminue le remplissage des espaces sinusoïdes du tissu érectile qui se traduit par un défaut de rigidité de la verge en réponse à une stimulation sexuelle. L’athérosclérose, le plus souvent diffuse, est la cause quasi exclusive de cette anomalie. Les facteurs de risque en sont bien connus : l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète et le tabagisme. La mise en évidence depuis une décennie dans de nombreux travaux épidémiologiques d’un lien fort entre maladie coronarienne et DE fait désormais considérer qu’il s’agit en fait de la même maladie. Ainsi est né le concept de la DE « sentinelle » préexistant souvent à la coronaropathie symptomatique, véritable signe d’alerte d’une dégradation de la santé vasculaire du patient. Cette notion est aujourd’hui largement acceptée par la communauté cardiologique. Des lésions traumatiques des artères caverneuses peuvent également exister, essentiellement chez des patients jeunes après traumatisme pelvipérinéal grave. Des lésions des artères pudendales accessoires lors de la prostatectomie totale peuvent participer à la physiopathologie de la DE postprostatectomie. Le défaut de perfusion artérielle du tissu érectile, via l’hypoxie qu’il entraîne, est responsable d’anomalies biochimiques qui touchent en particulier les enzymes de synthèse du monoxyde d’azote (NO synthases) aboutissant à une moindre capacité du tissu érectile à se relâcher précipitant donc la survenue de la DE. L’acteur cellulaire principal de ces anomalies est la cellule endothéliale. La dysfonction endothéliale est reconnue aujourd’hui comme le principal mécanisme physiopathologique cellulaire responsable du lien entre DE et maladies cardiovasculaires en général. La dysfonction endothéliale est une conséquence des pathologies et des facteurs de risque déjà évoqués : l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète et le tabagisme. On peut sans doute y ajouter le syndrome métabolique et la sédentarité. La cellule endothéliale synthétise et libère le NO en réponse à une stimulation mécanique, force de cisaillement shear stress , opérée par le flux sanguin. Lorsque ces mécanismes intracellulaires sont défaillants, le déficit de NO a pour conséquence une moindre relaxation du tissu érectile. Chez les patients diabétiques, la production de NO d’origine nerveuse et endothéliale est altérée, ce qui explique la difficulté à traiter la DE de ces patients avec les IPDE5. L’hypercontractilité musculaire lisse est un mécanisme physiopathologique de description plus récente que les précédents. Cette contraction exagérée des cellules musculaires lisses caverneuses est due à une dysrégulation des voies de signalisation contrôlant le tonus musculaire lisse. L’hyperactivité des kinases C et de la Rho-kinase serait à l’origine de cette augmentation du tonus contractile. Une telle augmentation a été retrouvée dans des modèles expérimentaux de diabète et d’hypertension. Une diminution des cellules musculaires lisses caverneuses a été mise en évidence chez les patients souffrant de DE organique. Associée à une augmentation de la densité du tissu conjonctif, cette modification de la structure du tissu érectile est responsable d’un défaut du mécanisme veino-occlusif facteur de DE. Des anomalies de ce type ont été retrouvés dans des modèles expérimentaux de DE chez des animaux hypertendus. Elles ont été également décrites dans le tissu érectile de patients après prostatectomie totale. La rééducation pharmacologique dans ce groupe de patients a pour but d’empêcher l’apparition d’une telle fibrose. Le rôle de la testostérone sur le désir est bien connu. Le déficit en testostérone affecte en premier lieu la survenue des érections nocturnes dont la commande cérébrale est androgéno-dépendante. Les érections nocturnes pourraient jouer un rôle sur la trophicité du tissu érectile. Par ce biais, un déficit en testostérone pourrait retentir sur la fonction érectile en particulier chez le sujet âgé. Le rôle direct de la testostérone sur les mécanismes locaux de l’érection reste non démontré. Les preuves à ce sujet ont été acquises lors d’expérimentations réalisées chez des animaux castrés, condition expérimentale qui diffère beaucoup du déficit partiel en androgènes de l’homme avançant en âge. On explique ainsi l’absence ou le peu d’effet de la supplémentation en testostérone sur la DE de l’homme vieillissant. Le diagnostic de DE repose sur le déclaratif du patient. Les questionnaires (cf. Questionnaires en médecine sexuelle) peuvent aider au diagnostic et permettre une évaluation plus objective de la sévérité du symptôme. Les questionnaires ne peuvent pas se substituer à l’interrogatoire détaillé du patient. La première consultation pour DE est toujours longue. L’interrogatoire est fondamental et il demande du temps à la recherche des nombreux facteurs de risque et/ou causaux qui peuvent être impliqués. On doit faire préciser les symptômes concernant la sexualité, les antécédents médicaux (maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, dépression…), chirurgicaux, traumatologiques, les traitements médicaux (cf. Iatrogénie médicamenteuse en médecine sexuelle). Il faut s’assurer qu’il s’agit bien d’une difficulté d’érection. La sévérité, la durée et le mode du début de la DE en particulier dans les suites d’un traumatisme psychoaffectif éventuel doivent être précisés. Il s’agit aussi de connaître le contexte dans lequel le patient vit sa sexualité, en particulier l’existence ou non d’une partenaire et en fonction des circonstances l’histoire sexuelle du patient, les longues périodes d’abstinence éventuelles doivent en particulier être renseignées. Il faut enfin être informé sur les conditions économiques du patient. L’insuffisance érectile ne concerne pas que l’homme mais le couple. Idéalement, la partenaire participe également à la consultation. Sa présence peut s’avérer indispensable pour apprécier la situation du couple et l’attitude de la partenaire face à la DE et son acceptation des traitements potentiels. L’examen clinique est fortement recommandé. Les caractères sexuels secondaires seront recherchés ainsi que des anomalies des organes géniaux externes, en particulier des signes de maladie de Lapeyronie. Le toucher rectal doit être réalisé chez tout homme qui vieillit. En fonction du contexte, un examen neurologique sommaire peut être réalisé ainsi que la prise des pouls périphériques. La mesure tensionnelle est systématique, si le patient n’est pas suivi par ailleurs. Au plan biologique, en l’absence de données récentes, seuls une glycémie à jeun et un bilan lipidique doivent être demandés. Si la libido est diminuée, la suspicion d’un déficit androgénique fait réaliser un dosage matinal de la testostéronémie totale et biodisponible éventuellement répété à quelques jours d’intervalle. Il n’y a pas d’indication en routine pour des investigations plus spécialisées comme le pharmaco-échodoppler pénien, la rigidimétrie pénienne nocturne ou lors d’une stimulation visuelle. Le bilan neurophysiologique périnéal doit être réservé aux très rares patients chez lesquels des troubles de la sensibilité pelvipérinéale, voire d’autres signes d’atteinte neurologique coexistent avec la DE qui peut être alors associée à des troubles mictionnels d’apparition récente et/ou des troubles de l’éjaculation et/ou de l’orgasme.
| | Prise en charge non médicamenteuse | La prise en charge des facteurs de risque et des comorbidités (maladies ou facteurs de risque cardiovasculaires, diabète, dépression…) doit accompagner le traitement médicamenteux de l’insuffisance érectile. Une hygiène de vie déficiente doit être corrigée : obésité, tabagisme, alcoolisme ou usage de stupéfiants. Chez des hommes de la cinquantaine, une augmentation de l’activité physique a diminué l’incidence de la DE [10]. Une prise en charge pendant une période de deuxans d’hommes de la cinquantaine à risque consistant à délivrer des informations sur comment perdre du poids, améliorer son alimentation et augmenter son activité physique s’est avérée capable d’améliorer la fonction érectile [11]. L’activité physique chez le diabétique diminue de près de 40 % le risque de DE [12]. Les causes psychosociales doivent également être prises en charge lorsque cela s’avère possible : conflits dans le couple, problèmes relationnels et autres problèmes psychologiques. L’approche psychosexologique a fait progresser le diagnostic, la compréhension et in fine la connaissance du symptôme DE. Cependant, la prise en charge psychosexologique isolée de la DE n’a pas fait la preuve de son efficacité dans des essais contrôlés regroupant un effectif important de patients. De nombreuses techniques et approches psychosexologiques ont été proposées pour la DE. Elles font intervenir en particulier la désensibilisation sensate focus , la thérapie de couple, la thérapie comportementale, l’éducation sexuelle (cf. Sexologie). La prise en charge psychosexologique poursuit les buts suivants : réduire ou abolir l’anxiété de performance, comprendre le contexte de la sexualité du patient ou du couple, mettre en œuvre un apprentissage et un changement des scénarii sexuels, identifier les résistances et identifier et diminuer les résistances à l’arrêt prématuré de l’aide pharmacologique [4]. Certains médicaments sont délétères pour la fonction érectile : essentiellement antidépresseurs inhibiteurs de recapture de la sérotonine, neuroleptiques, antihypertenseurs diurétiques (cf. Iatrogénie médicamenteuse en médecine sexuelle). La modification des posologies, le changement des traitements peut s’avérer efficace sur la DE. Ces modifications de traitements ne se conçoivent qu’en concertation étroite avec le médecin prescripteur. Lors du diagnostic de DE, l’appréciation de l’état cardiovasculaire du patient est indispensable, d’une part dans le cadre de l’enquête étiologique et d’autre part dans le contexte d’une prescription médicamenteuse. La question à laquelle il faut répondre est la suivante : le patient peut-il fournir l’effort physique correspondant à celui développé lors d’un rapport avec pénétration vaginale ? Jusqu’à l’orgasme cet effort correspond environ deux à trois fois les dépenses de l’organisme. Au moment de l’orgasme l’effort correspond trois à quatre fois les dépenses de l’organisme. Par comparaison, une marche à 3 à 5km/h en terrain plat multiplie les dépenses de l’organisme par deux à trois. Durant un rapport sexuel, les paramètres cardiaques se modifient. La fréquence cardiaque maximum est de 130 battements/min et pression artérielle systolique maximum atteint 170mmHg. Globalement, l’intensité de l’effort physique lors d’un rapport sexuel correspond à la montée de deux à trois étages [13]. Si le patient ne peut pas effectuer l’effort physique correspondant, un bilan cardiovasculaire s’impose avec réalisation d’explorations complémentaires et institution d’un traitement afin de stabiliser l’état cardiovasculaire. Dans l’intervalle, la prescription d’un quelconque traitement de la DE est contre-indiquée. Il est par ailleurs recommandé d’informer les patients sur les risques, les bénéfices ainsi que le coût des différents traitements, la plupart n’étant en effet pas pris en charge. La participation active du patient dans la décision thérapeutique est très souhaitable. La partenaire peut être associée à cette décision. Enfin, il faut souligner que le médecin a également un rôle d’éducation en matière de sexualité.
|
|
Traitements pharmacologiques [ 14] |
| | Ils représentent le traitement de première intention de la DE chez la grande majorité des patients (Tableau 1). Les inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5 (IPDE5). Il s’agit de la classe pharmacologique de référence pour le traitement oral symptomatique à la demande de la DE. L’efficacité des médicaments de cette classe varie en fonction de l’étiologie de la DE. Les IPDE5 sont efficaces chez environ deux tiers des patients toutes étiologies confondues. Les IPDE5 sont d’une efficacité limitée après prostatectomie totale, chez les patients diabétiques et/ou souffrant d’une pathologie cardiovasculaire évoluée. Il existe des effets secondaires communs aux médicaments de cette classe : céphalées, dyspepsie, rougeurs du visage et encombrement nasal. Des troubles de la vision et des lombalgies peuvent exister en fonction des molécules. Un traitement par dérivés nitrés ou donneurs de monoxyde d’azote est une contre-indication absolue du fait d’un risque d’hypotension majeure. Les IPDE5 sont des facilitateurs de l’érection. Leur effet ne s’exerce donc que s’il y a stimulation sexuelle. Le patient doit en être informé lors de la première prescription. L’absence de stimulation sexuelle est une cause fréquente d’inefficacité. L’effet facilitateur apparaît dans l’heure suivant la prise pour le vardénafil et le sildénafil, dans les deuxheures suivant la prise pour le tadalafil. La durée de cet effet est variable : de quelques heures pour le sildénafil et le vardénafil à 36heures pour le tadalafil. Sildénafil 25, 50 et 100mg : • | Viagra® 25, 50 et 100mg Grade A.
|
Vardénafil 5, 10 et 20mg : • | Lévitra® 5, 10 et 20mg Grade A ;
| • | Lévitra® orodispersible 10mg.
|
Tadalafil 10 et 20mg : • | Cialis® 10 et 20mg Grade A.
|
Le tadalafil est également enregistré à la posologie de 5mg pour un traitement quotidien. Il est indiqué chez les patients souffrant de dysfonction érectile. Cette posologie sera également enregistrée d’ici la fin de l’année 2012 dans l’indication troubles mictionnels en lien avec une hypertrophie bénigne de prostate avec ou sans DE associée. Tadalafil 5mg : La yohimbine est indiquée dans le « traitement d’appoint de l’impuissance masculine ». Il s’agit d’un traitement quotidien. Son efficacité est minime. Posologie 10 à 15mg en trois prises quotidiennes : • | Yocoral® 5mg ;
| • | Yohimbine Houdé® 2mg.
|
Ils sont indiqués en cas d’échec ou de contre indications des traitements oraux et dans de rares cas pour préférences personnelles. Il s’agit d’inducteurs de l’érection. Ainsi, à l’inverse des traitements oraux, la stimulation sexuelle n’est pas nécessaire à leur effet. Tous les traitements locaux nécessitent un apprentissage médicalisé : • | injections intracaverneuses ;
| • | prostaglandine E1 (PGE1).
|
La délivrance de PGE1 s’effectue par auto-injection dans l’un des corps caverneux. L’efficacité est élevée quelle que soit l’étiologie de l’insuffisance érectile, l’acceptabilité est moindre que pour les traitements oraux. Les contre indications sont les antécédents de priapisme et la drépanocytose qui expose au priapisme. Grade A. Les douleurs péniennes représentent l’essentiel des effets secondaires locaux. Elles sont présentes essentiellement dans les suites de prostatectomie totale et chez les diabétiques. Le priapisme est très rare et résulte d’une augmentation intempestive de la posologie. La répétition des injections est rarement responsable de la survenue d’une fibrose caverneuse. Alprostadil 10, 20μg, lyophilisat et solvant à reconstituer : • | Caverject® standard ou dual (dispositif permettant la reconstitution du mélange lyophilisat et solvant avant l’injection sans manipulation) 10,20μg.
|
Alprostadil–alphacyclodextrine 10, 20μg, lyophilisat et solvant à reconstituer : • | Edex® comportant un dispositif permettant la reconstitution du mélange lyophilisat et solvant et l’injection.
|
|
|
Injections intracaverneuses | Les injections intracaverneuses de PGE1 sont remboursées à 30 % par l’assurance maladie dans certaines indications (Tableau 2). Dans ce cas la prescription doit être rédigée sur une ordonnance dite « d’exception ». La papavérine n’a pas l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement de la DE. Cependant, son utilisation peut être considérée comme validée par l’usage. La papavérine n’occasionne pas les douleurs dont peut être responsable la PGE1 chez certains patients. La détermination de la posologie optimale est un peu plus délicate que celle de la PGE1. Son effet peut varier. Elle serait plus souvent responsable de fibrose du tissu érectile. La posologie utile maximale est de 80mg.
|
|
Délivrance intra-urétrale de prostaglandine E1 | Il s’agit de l’auto-administration dans la portion distale de l’urètre de PGE1 à l’aide d’un dispositif à usage unique. Cette formulation a une efficacité moindre que les injections intracaverneuses de PGE1. Elle est responsable de douleurs péniennes et dans de rares cas d’hypotension, voire de syncopes. Alprostadil : • | Muse® 1000μg PGE1 Grade A.
|
À noter le passage possible de la PGE1 dans le sperme d’où la recommandation d’une contraception si la partenaire est susceptible d’être enceinte.
| | Traitements non pharmacologiques | C’est un dispositif mécanique comprenant un cylindre placé sur la verge et appliqué sur le pubis dans lequel le patient fait le vide à l’aide d’une pompe manuelle ou électrique. L’érection ainsi obtenue par dépression à l’intérieur du cylindre est maintenue après avoir ôté le cylindre par une bande constrictive élastique placée à la racine de la verge. Il s’agit d’un dispositif efficace mais dont l’acceptabilité est variable. Un apprentissage de l’utilisation de l’appareil est nécessaire. Les effets secondaires sont minimes comprenant des douleurs, une sensation de pénis froid et parfois des difficultés à l’éjaculation. Grade B. Mise en place d’une prothèse pénienne ou implant pénien. Il en existe plusieurs modèles : semi-rigides ou malléables et gonflables. Il s’agit d’une option thérapeutique invasive et irréversible. Il s’agit d’un traitement de dernière intention qui peut s’avérer très efficace en termes de satisfaction des patients [15]. Les prothèses ne doivent pas être proposées aux patients incapables de manipuler la pompe. Le patient doit être informé : • | qu’il ne retrouvera pas la taille de la verge en érection qu’il connaissait avant la DE et ;
| • | que la prothèse ne permet pas l’obtention d’une érection du gland [ 4]. |
Les effets secondaires sont représentés par les infections du matériel, 1 à 5 %, qui nécessitent souvent l’ablation de la prothèse. Les prothèses gonflables sont grevées d’un taux de défaillance mécanique estimé à 5 % la première année, 20 % à cinqans et 50 % à dix ans. Les prothèses péniennes demeurent l’exception, il s’en pose actuellement environ 300 par an en France. Grade B.
|
|
Chirurgie de revascularisation | Les pontages artériels microchirurgicaux et les ligatures veineuses permettent chez des patients jeunes, le plus souvent après un traumatisme pelvipérinéal, une amélioration de la vascularisation pénienne. Les indications exceptionnelles de ce type de chirurgie nécessitent l’intervention d’un chirurgien spécialisé. Accord pro. La physiopathologie de la DE, même si elle est complexe, est désormais bien connue. Elle peut varier considérablement d’un patient à l’autre en fonction du contexte étiologique. La résultante de l’altération isolée ou associée des différents mécanismes locaux de l’érection est univoque, c’est le défaut de remplissage des corps caverneux par le sang artériel en réponse à une stimulation aboutissant à une rigidité plus ou moins insuffisante. L’efficacité des traitements pharmacologiques dont nous disposons aujourd’hui ne doit pas faire oublier qu’il s’agit de traitements symptomatiques. Seules, peut-être, des mesures hygiénodiététiques associées à une activité physique régulière peuvent permettre de modifier l’histoire naturelle de la DE. Néanmoins, le concept de rééducation pharmacologique dans les suites par exemple d’une prostatectomie totale est sans doute pertinent. Au total, la stratégie thérapeutique dans la DE est très pragmatique. L’affirmation du diagnostic et l’absence de contre indications font prescrire dans un premier temps un IPDE5. Cette prescription doit impérativement être accompagnée d’instructions précises quant à l’utilisation du traitement. Il est également fondamental de revoir rapidement le patient après quelques essais. Le soutien psychologique, les encouragements ainsi que l’écoute sont autant d’éléments qui, associés à l’aide pharmacologique, aideront le patient dans sa récupération d’une sexualité plus satisfaisante. Ce suivi et ce soutien sont des facteurs clef de succès d’un traitement pharmacologique bien conduit. En cas d’échecs ou de rares contre-indications, les traitements locaux pharmacologiques ou non permettent de traiter la grande majorité des patients. Une des causes d’échecs des traitements oraux est l’existence de conjugopathie ou de problèmes psychologiques qui doivent faire associer à l’aide pharmacologique une prise en charge psychosexologique adaptée.
 • | Chez un homme vieillissant, la DE est une maladie cardiovasculaire jusqu’à preuve du contraire.
| • | À facteurs de risque cardiovasculaires équivalents, l’existence d’une DE expose à un risque accru d’accidents cardiovasculaires aigus : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, mort subite.
| • | Les IPDE5 sont efficaces chez deux tiers des patients souffrant de DE toutes étiologies confondues.
| • | Deux modes de traitement médicamenteux par voie orale sont aujourd’hui disponibles : IDPE5 à la demande (sildénafil, vardénafil, tadalafil) et IPDE5 traitement quotidien (tadalafil).
| • | Les traitements de deuxième intention : injections intracaverneuses de PGE1 et vacuum permettent de traiter la grande majorité des patients non répondeurs aux IPDE5.
| • | Lorsque l’indication est bien posée, les implants péniens ont un taux de satisfaction élevé.
| • | La prise en charge des patients se plaignant de DE n’est pas univoque, la prise en compte du contexte dans lequel ils vivent leur sexualité est indispensable.
|
Stéphane Droupy : consultant : Lilly, Ménarini, Takeda, Sanofi, Ferring, Astellas ; orateur : Lilly, Ipsen, Astra-Zeneca, Abbott, Intuitive ; investigateur : Lilly. François Giuliano : consultant : Lilly, Ménarini, GSK, Bayer, Allergan ; orateur : Lilly, Pfizer, Vivus ; investigateur : Lilly, Johnson & Johnson, GSK. | |
| ☆ | Cet article fait partie intégrante du rapport « Médecine sexuelle » du 106e congrès de l’Association française d’urologie rédigé sous la direction de Florence Cour, Stéphane Droupy et François Giuliano.
|
| |
Tableau 1 - Médicaments ayant l’AMM en France pour le traitement de la DE.
|
| Dénomination Commune Internationale | Nom commercial | Présentations | Posologie | Caractéristiques | | Alprostadil | Caverject® | Injection intracaverneuse | 10, 20μg | À la demande | | | | Standard, dual | | Remboursement dans certaines indications | | | | Alprostadil alfadex | Edex® | Injection intracaverneuse | 10, 20μg | À la demande | | | | 2 seringues par boîte | | Remboursement dans certaines indications
(Tableau 2) | | | | Sildénafil | Viagra® | 25mg boîte de 4, 8 cps | Cps 25, 50, 100mg | À la demande | | | | 50mg boîte de 2, 4, 8, 12 cps | | Non remboursé | | | | 100mg boîte de 4, 8, 12 cps | | | | | | Vardénafil | Lévitra® | 10mg boîte de 4, 8 cps | Cps 10, 20mg | À la demande | | | | 20mg boîte de 4, 8,12 cps | 10mg cps orodispersibles | Non remboursé | | | | Etui de 4,8 cps | | | | | | Tadalafil | Cialis® | 10mg boîte de 4 cps | Cps 10, 20mg | À la demande | | | | 20mg boîte de 8 cps | | Non remboursé | | | | 5mg boîte de 28 cps | Cps 2,5 et 5mg | | | | | 2,5mg boîte de 28 cps | | Quotidien | | | | | | Non remboursé | | | | Yohimbine | Yocoral® | 5mg boîte de 100 cps | Cps 5mg 3 à 4 cps/j en 3 prises | Quotidien | | | | | | Non remboursé | | | | Yohimbine | Yohimbine Houdé® | | Cps 2mg 8 à 10 cps/j en 3 prises à distance des repas | Quotidien | | | | | | Non remboursé | | | | Alprostadil | Muse® | Délivrance intra-urétrale | 1000μg | À la demande | | | | 1000μg pour usage urétral boîte de 1 sachet | | Non remboursé |
Tableau 2 - Conditions de remboursement des injections intracaverneuses de prostaglandine E1 (PGE1) Remboursement 35 %.
|
| Inscription des injections intracaverneuses de PGE1 sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en cas de dysfonction érectile marquée (absence d’érection ou érection ne permettant pas un rapport sexuel) chez les patients souffrant de | | Paraplégie traumatique | | Traumatisme du bassin compliqué de troubles urinaires | | Séquelles chirurgicales (anévrisme de l’aorte ; prostatectomie radicale, cystectomie totale et exérèse colorectale) | | Séquelles radiothérapiques | | Séquelles du priapisme | | Neuropathies diabétiques avérées | | Sclérose en plaques |
Légende :
Taux de remboursement : 35 % Statut de médicament d’exception.
|
|
| |
| Lue T.F., Giuliano F., Montorsi F., Rosen R.C., Andersson K.E., Althof S., et al. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions in men J Sex Med 2004 ; 1 : 6-23 [cross-ref] | | | Cour F., Fabbro-Peray P., Cuzin B., Bonierbale M., Bondil P., de Crecy M., et al. Recommendations to general practice doctors for first line management of erectile dysfunction Prog Urol 2005 ; 15 : 1011-1020 | | | Montague D.K., Jarow J.P., Broderick G.A., Dmochowski R.R., Heaton J.P., Lue T.F., et al. Erectile dysfunction guideline update panel Chapter 1: the management of erectile dysfunction: an AUA update J Urol 2005 ; 174 : 230-239 [cross-ref] | | | Montorsi F., Adaikan G., Becher E., Giuliano F., Khoury S., Lue T.F., et al. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions in men J Sex Med 2010 ; 7 : 3572-3588 [cross-ref] | | | Hatzimouratidis K., Amar E., Eardley I., Giuliano F., Hatzichristou D., Montorsi F., et al. Guidelines on male sexual dysfunction: erectile dysfunction and premature ejaculation Eur Urol 2010 ; 57 : 804-814 [cross-ref] | | | Lewis R.W., Fugl-Meyer K.S., Corona G., Hayes R.D., Laumann E.O., Moreira E.D., et al. Definitions/epidemiology/risk factors for sexual dysfunction J Sex Med 2010 ; 7 : 1598-1607 [cross-ref] | | | Gazzaruso C., Giordanetti S., De Amici E., Bertone G., FalconeC, Geroldi D., et al. Relationship between erectile dysfunction and silent myocardial ischemia in apparently uncomplicated type 2 diabetic patients Circulation 2004 ; 110 : 22-26 [cross-ref] | | | Gratzke C., Angulo J., Chitaley K., Dai Y.T., Kim N.N., Paick J.S., et al. Anatomy, physiology, and pathophysiology of erectile dysfunction J Sex Med 2010 ; 7 : 445-475 [cross-ref] | | | Lue T.F. Erectile dysfunction N Engl J Med 2000 ; 342 : 1802-1813 [cross-ref] | | | Derby C.A., Mohr B., Goldstein I., Feldman H.A., Johannes C.B., McKinlay J.B. Modifiable risk factors and erectile dysfunction: can life-style changes modify risk? Urol 2000 ; 56 : 302-306 [inter-ref] | | | Esposito K., Ciotola M., Giugliano F., Maiorino M.I., Autorino R., De Sio M., et al. Effects of intensive lifestyle changes on erectile dysfunction in men J Sex Med 2009 ; 6 : 243-250 [cross-ref] | | | Rosen R.C., Wing R.R., Schneider S., Wadden T.A., Foster G.D., West D.S., et al. Erectile dysfunction in type 2 diabetic men: relationship to exercise fitness and cardiovascular risk factors in the look AHEAD trial J Sex Med 2009 ; 6 : 1414-1422 [cross-ref] | | | Nehra A., Jackson G., Miner M., Billups K.L., Burnett A.L., Buvat J., et al. The Princeton III Consensus Recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease Mayo Clin Proc 2012 ; 87 : 766-778 [cross-ref] | | | Giuliano F. Dysfonctio in érectile in Vidal éditions Vidal Recos : (2012). 684-91.
| | | Menard J., Tremeaux J.C., Faix A., Pierrevelcin J., Staerman F. Erectile function and sexual satisfaction before and after penile prosthesis implantation in radical prostatectomy patients: a comparison with patients with vasculogenic erectile dysfunction J Sex Med 2011 ; 8 : 3479-3486 | |
| | | | | |
© 2013
Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. | | | | |
|